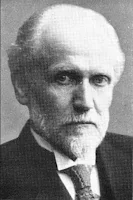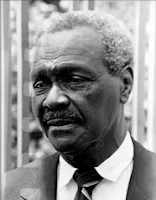Deuxième partie

Ottawa, ce jeudi 8mars 2018
Dans la première partie de l’article,
l’auteur a effectué un survol rapide des
problèmes de la gourde que qu’il a observés dans le cadre de ses fonctions
à la Banque Nationale de la République
d’Haïti, la BNRH, entre 1967 et 1970. Dans cette deuxième partie, il effectue
un rappel de quelques notions générales sur la monnaie et les changes, puis il
aborde à vol d’oiseau quelques-uns des problèmes que pose l’abolition de la
liberté absolue des changes en Haïti.
 |
| Le complexe ultramoderne de la Banque de la République d'Haïti à la rue du Quai. |
Un rappel de quelques notions générales sur le sujet
La monnaie
D’abord, c’est quoi la monnaie et
quels sont ses liens avec le niveau des prix en général et le taux de change en
particulier? Selon une des définitions les plus courantes, la monnaie est une
marchandise universelle qui sert d’intermédiaire dans les échanges. Elle a un
pouvoir d’achat intérieur qui varie en
sens inverse de l’évolution des prix et elle se vend sur les marchés
internationaux au prix, fixe ou variable, qu’est le taux de change. Sa valeur
reflète à la fois le volume des biens et services qu’elle permet d’acheter sur
le marché intérieur et la quantité de devises étrangères qu’elle procure par le
biais du taux de change. Quand les prix intérieurs augmentent, le pouvoir
d’achat de la monnaie diminue, de sorte
qu’il faut davantage d’unités de la monnaie nationale pour acheter une même
quantité de biens et services, ainsi qu’une unité de monnaie étrangère. Quand
la hausse des prix dépasse un certain seuil, on parle d’inflation. Dans le
scénario inverse, la chute des prix, on parle de déflation.
Le taux de change
Et le taux de change, c’est quoi?
C’est, sur une base unitaire, la quantité de monnaie nationale qu’il
faut débourser pour acheter une unité de devise étrangère, le dollar par
exemple. Quand tous les prix augmentent
dans l’économie et que le prix de la devise étrangère, le taux de
change, reste stable, la devise étrangère devient la marchandise la moins
chère disponible sur le marché. Dans les
conjonctures d’instabilité économique et politique, les agents économiques se
ruent sur elle, et les réserves de la banque centrale stagnent, diminuent ou s’épuisent même. À la limite, ce phénomène
peut priver le pays des moyens
nécessaires au financement de son développement. Durant les années 1960, cela
s’est produit dans la plupart des pays d’Amérique latine qui ont institué le
contrôle des changes en dérogeant aux prescriptions du Fonds monétaire en la
matière.
 |
| Pierre-Paul Shweitzer Dir. gén. du FMI et Eddy Cavé à Washington en 1969. |
Je me rappelle avoir eu, en 1968, à expliquer à une délégation du FMI de
passage à Port-au-Prince un certain nombre de
mesures sans gravité aucune prises par Haïti pour pallier la rareté du
dollar et pour stimuler la production d’articles de consommation locale comme
la patte de tomates, les allumettes, la cire à chaussures. Pour avoir étudié la
méthodologie de la balance des paiements à l’Institut du FMI à Washington et les
stratégies de politique commerciale à la Commission économique pour l’Amérique
latine (CEPAL) à Santiago du Chili, je savais que ces mesures étaient largement
appliquées dans les pays en développement et faisaient partie de la marge de
manœuvre dont disposent les États souverains pour assurer leur croissance.
Quelle absurdité!
La double circulation
monétaire
 |
| SirThomas Gresham 1519 - 1579 |
Ce phénomène a été examiné dès le 16e siècle par le financier
britannique Thomas Gresham qui en a exposé les méfaits dans sa fameuse
loi : « La mauvaise monnaie chasse la bonne.» Dans la pratique, lorsque deux monnaies
circulent simultanément sous un régime de taux de change fixe, les agents économiques
se défont tout naturellement de la moins forte des deux et ils utilisent la
plus forte comme instrument de thésaurisation ou d’épargne. Plus de quatre siècles après avoir
été formulée, cette découverte de Gresham demeure d’une étonnante actualité. La solution la plus courante aux problèmes de ce type est l’abolition de la
double circulation et l’adoption de son antidote, le contrôle des changes. Plus facile à dire qu’à faire.
En reliant les deux sujets que nous venons d’aborder, nous voyons
que la monnaie, étant une marchandise
comme une autre, son prix doit suivre celui de l’ensemble des autres prix, qui
est mesuré par l’indice des prix à la consommation. Cela tempère au moins
l’attrait de la devise étrangère comme valeur refuge et ralentit le processus
d’épuisement des réserves de la Banque centrale. Et comme les agents
économiques n’effectuent pas nécessairement leurs transactions dans l’optique
des intérêts nationaux ou du bien commun, l’État est en quelque sorte forcé de
recourir à la coercition des lois et des règlements pour poursuivre ses
objectifs de stabilisation des prix et du taux de change et de protection des
réserves de change du pays. La presque
totalité des études réalisées sur les stratégies de développement adoptées en
Amérique latine après la Deuxième Guerre mondiale confirment cette assertion.
Haïti a été une des exceptions notoires. Il est peut-être temps de corriger les
errements commis, mais cela ne peut pas se faire de n’importe quelle façon.
Dollarisation et
Dédollarisation
Un terme qui revient souvent dans les analyses de conjoncture des deux
dernières décennies et même dans les conversations courantes en Haïti est celui
de dollarisation. Ce terme désigne en
général la disparition graduelle de la monnaie nationale au profit du dollar
dans les transactions commerciales locales. Dans le cas d’Haïti, toutefois, la
dollarisation s’est étendue dans les moindres aspects de la vie, y compris dans
les rapports et les dons entre pères et fils, entre frères et sœurs, entre conjoints, entre amis,
etc. Tout se passe en dollars.
Pour des raisons de commodité sans doute, les autorités monétaires ont
pris l’habitude de mesurer la dollarisation de l’économie haïtienne par la
proportion des dépôts bancaires tenus en dollars. Ce chiffre est certainement
un indicateur très utile, mais il sous-estime grandement l’ampleur du
phénomène.
Décriée par le mouvement altermondialiste comme portant atteinte à la
souveraineté des États économiquement faibles, la dollarisation a
indiscutablement présenté beaucoup d’aspects positifs pour Haïti, mais elle a pris
de telles proportions au cours des 20 dernières années qu’elle en est venue à
menacer l’existence même de la gourde. De fait, ils ne sont pas rares les gens
qui estiment que le dollar pourrait facilement remplacer la gourde et que la
banque centrale pourrait avantageusement se transformer en une simple caisse
d’émission. On l’a vu dans de nombreux pays, par exemple au Maghreb en 1989, en
Argentine en 1991, en Bulgarie en 1997, etc. L’Équateur est le premier pays à
avoir procédé à la dollarisation totale de son économie. Précisons que, sous le
régime de la caisse d’émission, l’intégralité de la circulation monétaire est
couverte par les avoirs en devises de la Caisse.
 |
| L'arrêté de Jovenel déclarant la gourde,seule monnaie ayant coiurs en Haïti. |
Au vu des dangers de la
dollarisation au chapitre de la souveraineté nationale et au vu de ses limites sur le plan économique, les économistes et les décideurs de
différents pays, dont la Chine et la Russie, ont entrepris ces derniers temps
de dédollariser leur l’économie, le mot étant pris dans le sens de réduction de
l’influence de toutes les monnaies fortes, notamment l’euro. En Haïti, Le
Nouvelliste sonnait l’alarme le 5
décembre 2017 en publiant un article de l’économiste Junior Armel Bélizaire
intitulé : « Se dirige-t-on vers une dédollarisation de l’économie
haïtienne? » Cet article faisait écho à une circulaire du 11 août 2017
obligeant les banques commerciales et
les sociétés de cartes de crédit à régler exclusivement en gourdes toutes les
opérations effectuées avec une carte de crédit émise en Haïti, quel que soit le
lieu où elles ont été faites. On voit maintenant que la balle avait été lancée
à ce moment-là, mais personne n’a vu venir le smash mortel.
Les défis à surmonter
C’est dans le contexte de la dédollarisation implicitement annoncée de
l’économie qu’est survenue sans préavis la publication de l’Arrêté Jovenel
Moïse. Instituer la circulation exclusive de la gourde implique au moins une
dédollarisation partielle et progressive de l’économie, ce qui ne se fait pas
du jour au lendemain. Pour donner une idée de l’ampleur du défi que constitue,
à tous les niveaux de l’économie, l’abolition de la double circulation
monétaire, il suffit de rappeler qu’au cours des dernières années, les agents
économiques ont complètement perdu confiance dans la gourde et qu’ils ont
converti en dollars la plus grande partie de leurs avoirs liquides haïtiens. Voyons
ce qu’en dit sur le sujet, à la page 37, Le Rapport annuel 2015 de la Banque
centrale :
« Au 30 septembre 2015, la structure de la
dette publique externe par type de devises a fait ressortir un niveau de
dollarisation relativement élevé. En effet, le portefeuille de dette externe
est à 93,76 % exprimé en dollars tandis que les droits de tirage spéciaux (DTS)
n’ont représenté que 6,24 %. »
À la page
57, les auteurs du Rapport ajoutent :
« En hausse
de 1,93 point de pourcentage, la part des dépôts en devises dans les dépôts
totaux s’est établie à 59,28 %, en raison, d’une part, de la croissance plus
soutenue (+17,8 %) des dépôts en devises converties que celle (+8,78 %) des
dépôts en gourdes et, d’autre part, de l’appréciation substantielle (+14,46 %)
du taux de change entre septembre 2014 et septembre 2015. »
 |
| Spécimen d'une gourde haïtienne en 1887 |
Étant donné que les réflexes de multiplication et de division par 5
n’ont toujours pas disparu dans nos habitudes de conversion de devises,
peut-être qu’il y aurait certains avantages à sortir de l’ombre le dollar
fictif haïtien de 5 gourdes souvent évoqué dans les conversations et lui donner
vie! Une nouvelle gourde valant 5 ou 50 anciennes pourrait être aussi une idée. Cela
faciliterait au moins les calculs.
En guise de conclusion
Comme nous l’avons vu, l’application de l’Arrêté Moïse implique au moins
deux décisions radicales intimement liées l’une à l’autre : une dédollarisation
de l’économie et l’institution d’un contrôle des changes. Il appartiendra aux
pouvoirs publics de décider s’ils vont ou non avancer dans cette voie. Il est
toutefois permis de se demander dès maintenant quelles sont, en théorie du
moins, les conditions du succès et les modalités d’application de l’éventuel contrôle
des changes? D’abord, l’existence d’un État fort, qui inspire confiance aux
administrés, qui a mis en place un dispositif administratif et juridique
approprié, qui prêche par l’exemple et entretient une communication honnête et
efficace avec les agents économiques. Du côté de ces derniers, il faudra un tel
souci de l’intérêt national et du bien commun que les particuliers et les
entreprises accepteront non seulement de
renoncer aux avantages et aux privilèges que la dollarisation leur accordait,
mais aussi d’accepter les sacrifices découlant du nouveau régime. Ils devront
aussi s’interdire les nombreuses initiatives susceptibles de faire dérailler le
processus de stabilisation envisagé. Un rêve en couleurs!
Force est donc d’admettre qu’aucune
de ces conditions n’existe en Haïti aujourd’hui, et je ne suis pas convaincu
non plus qu’elles étaient réunies non plus en 1967, quand je prêchais dans le
désert pour l’instauration d’un contrôle des changes. Pas plus qu’en 1974,
quand le jeune ministre du Commerce Serge Fourcand a tenté, au péril de sa vie,
de vendre aux pouvoirs publics l’idée d’abolir la double circulation monétaire
en Haïti. Dans la vie des peuples, comme dans celle des individus, rien de
grand ne se construit dans la facilité. L’instauration en Haïti d’une monnaie
unique est un objectif grandiose. Et il incombera aux dirigeants de trouver les
moyens de le réaliser.
L’éducation des agents économiques n’ayant jamais été faite au pays,
l’instruction civique étant devenue un
vague souvenir, les particuliers et les
entreprises ne comprennent pas qu’en
plaçant leurs économies à l’étranger, ils se tirent une balle dans le pied et
agissent à long terme contre leurs
propres intérêts et contre ceux du pays. La sensibilisation des citoyens est
pour cette raison un élément primordial de toute tentative de redonner au pays
la maîtrise de sa monnaie et de son avenir économique. Cela ne peut se faire
sur un coup-de-tête ni en un tournemain, peu de temps après une semaine de carnaval qui
a englouti des millions, dollars et gourdes confondus.
Au cours des 50 dernières années, l’autorité de l’État s’est effondrée,
la corruption s’est généralisée dans la gestion de la chose publique, le patriotisme a fait place à la démagogie et
à un nationalisme de mauvais aloi. Parallèlement, le pays perdait le gros des
ressources humaines et matérielles indispensables à la mise en œuvre de tout
projet économique et social de grande
envergure. S’il est trop tard pour donner le signal de départ et pour sonner
le rassemblement nécessaire à l’enterrement du régime séculaire de la double
circulation monétaire, il est trop tard également pour les autorités monétaires
et politiques de se rétracter sans plan d’évacuation. Cela sera d’autant plus
difficile qu’elles ne sont même pas sur la même longueur d’ondes même quand
elles parlent de questions de base comme l’ouverture de comptes en devises ou
d’opérations commerciales. À cela s’ajoutent la tiédeur du secteur privé dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il
digère mal d’avoir été complètement tenu à l’écart de la décision du 28 février
dernier.
Dans la société civile, c’est également la débandade, car il n’y a eu
aucun débat sur ce sujet qui non seulement interpelle chaque citoyen, mais
vient renverser sans préavis des habitudes séculaires dont presque personne n’a
jamais pris le temps d’évaluer les bons et les mauvais côtés. Nous sommes donc
à l’entrée d’une tour de Babel dont personne ne sait qui détient la clé. Retour à la première partie...
Eddy Cavé,
Écrivain